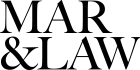27 Oct Questions/Réponses webinaire ADP du 17 octobre 2025 – Enquête RPS : mission impossible pour l’employeur ?
Enquête RPS : mission impossible pour l’employeur ?
Le Code du travail est clair : l’employeur à l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés (articles L. 4121-1 et suivants). Lorsqu’un signal de harcèlement ou de risques psychosociaux survient, il doit agir immédiatement, diligenter une enquête interne et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation.
Ignorer ou minimiser le problème, c’est s’exposer à une double sanction sur le plan juridique et sur le plan social. Mais sur le terrain, l’enquête RPS est tout sauf simple : peur de raviver les tensions, témoignages contradictoires, pression du CSE et des syndicats, risque que l’enquête se transforme en règlement de comptes.
L’occasion de faire le point sur cet exercice très particulier :
- Pourquoi les enquêtes RPS sont un terrain miné pour l’entreprise
- Les erreurs classiques qui coûtent cher à l’employeur,
- Les bonnes pratiques pour rester crédible, efficace et juridiquement solide,
- Comment transformer un moment de crise en véritable levier de prévention durable.
Vous pouvez encore visionner ce webinaire.

Y a-t-il une enquête RPS uniquement en cas de harcèlement moral ou sexuel ?
Non, une enquête RPS (risques psychosociaux) ne se limite pas aux cas de harcèlement moral ou sexuel.
Elle doit être déclenchée dès qu’un risque grave pour la santé mentale ou physique d’un salarié est signalé, même s’il n’y a pas encore de qualification juridique de harcèlement.
En pratique :
Une enquête interne peut être justifiée :
- Lorsqu’un salarié alerte sur une situation de mal-être, de surcharge, de conflit ou de perte de sens ;
- Quand un CSE ou un représentant du personnel fait remonter un risque psychosocial ;
- Après un arrêt maladie répété ou collectif évoquant des causes professionnelles ;
- Suite à un signalement anonyme ou indirect (par exemple, via une enquête de climat social).
⚖️ En revanche :
Si les faits évoquent explicitement du harcèlement moral ou sexuel, l’enquête doit être rapide, contradictoire et traçable, car elle relève aussi du cadre disciplinaire et pénal.

Peut-on obliger des salariés à être auditionnés ?
Non, on ne peut pas obliger un salarié à être auditionné.
La participation à une enquête interne repose sur le volontariat. Un salarié ne peut pas être contraint à témoigner, même si l’employeur lui en fait la demande.
Nuances importantes :
- L’employeur peut solliciter un entretien dans le cadre de son pouvoir de direction (pour comprendre une situation de travail, par exemple).→ Le salarié doit alors se présenter, mais il n’est pas obligé de s’exprimer sur des faits précis ou des personnes.
- Il est interdit de sanctionner un salarié qui refuse d’être auditionné ou de témoigner.
- En revanche, mentir sciemment lors d’une audition peut constituer une faute si cela nuit à autrui ou à l’entreprise.
En pratique :
➡️ Il est préférable :
- d’expliquer le cadre de l’enquête (objectifs, confidentialité, absence de sanction) ;
- de garantir l’anonymat ou la discrétion dans la rédaction des conclusions ;
- de recueillir un accord explicite avant chaque audition

Dans la délégation chargée de l’enquête, quels sont les intervenants extérieurs qui peuvent participer ?

Si la DRH considère que l’attitude d’un salarié pourrait être considérée comme un signalement faible, doit-elle enclencher une enquête ?
Si la DRH constate un “signal faible” (irritabilité, repli, tensions, absences inhabituelles, pleurs, conflits)
Elle n’a pas l’obligation légale immédiate d’ouvrir une enquête formelle,
mais elle a une obligation de vigilance et de réaction proportionnée (article L.4121-1 du Code du travail).
➡️ Elle doit donc :
- Recueillir les faits (échanges, observations, mails, témoignages),
- Prendre contact avec le salarié pour évaluer la situation,
- Tracer les démarches dans un registre interne ou une note confidentielle,
- Et agir sans délai si un risque avéré ou grave se confirme (enquête interne, signalement au CSE, alerte au médecin du travail…).
Si la DRH elle-même a un doute personnel
Oui, elle doit l’objectiver et le partager :
- soit avec le manager (si celui-ci est neutre dans la situation),
- soit avec le CSE ou le service de santé au travail.
L’enquête n’est déclenchée que si les éléments laissent supposer un risque réel pour la santé ou une situation potentiellement fautive.
➡️ Pas d’enquête à chaque ressenti, mais vigilance systématique + traçabilité.

Que faire si les témoins sont réticents à témoigner et se rétractent dès que nous évoquons un écrit ?
Aucune obligation légale de témoignage écrit
Le Code du travail n’impose ni la forme écrite, ni la signature du témoignage dans le cadre d’une enquête interne (hors procédure prud’homale).
Une note rédigée par l’enquêteur peut suffire, à condition d’être datée, objective et signée par lui.
Quelques exemples :
- Le témoin parle, mais refuse de signer : L’enquête rédige un compte rendu d’entretien (date, lieu, contenu factuel, refus de signature mentionné)
- Le témoin accepte un écrit, mais sans signature : conserver le mail ou le message s’il émane de lui-même sans signature
- Le témoin refuse tout écrit : noter dans le rapport d’enquête “entretien oral réalisé avec M. X, le…, propos recueillis sans validation écrite à la demande de l’intéressée”
- Le témoin craint les représailles : garantir l’anonymat dans la synthèse et rappeler la protection prévue par l’article L1152-2 du Code du travail
➡️ Bonnes pratiques de conformité
- Toujours rédiger un procès-verbal d’audition interne, même sans signature
- Mentionner la neutralité et l’absence d’interprétation des propos.
- Éviter les citations directes nominatives dans le rapport final, sauf accord explicite.
- Archiver les notes sous confidentialité RH.

Existe-t-il des modèles d’enquête avec méthodes ?
OUI, MAR&LAW propose des modèles complets d’enquête interne avec méthodologie structurée et outils prêts à l’emploi.
Nos kits comprennent :
✅ Guide méthodologique : étapes clés, principes de neutralité, traçabilité et conformité juridique ;
✅ Modèles de documents (trame de plan d’enquête, convocations à audition, comptes rendus d’entretiens (signés ou non), rapport final d’enquête ;
✅ Grilles d’entretien adaptables selon le type de risque (harcèlement, conflit, souffrance, alerte RPS) ;
✅ Fiche réflexe “Quand déclencher une enquête et comment la piloter” ;
✅ Et, bien sûr, formation associée à la conduite d’enquête interne et au traitement des signalements.
Vous souhaitez être accompagné dans la gestion de vos risques professionnels ?