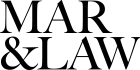19 Oct Questions/Réponses webinaire ADP – Obligation de sécurité et de prévention : comment l’entreprise peut-elle justifier de son respect –
Obligation de sécurité et de prévention : comment l’entreprise peut-elle justifier de son respect ?
Ce webinaire vous donne les clés pour passer d’une politique “formelle” à une stratégie réellement “prouvable”, en cas d’inspection ou de contentieux.
- Prévention primaire, secondaire, tertiaire : quelles preuves concrètes attendre ?
- Pertinence et traçabilité de l’obligation de prévention
- Eléments probatoires en matière d’alerte RPS, surcharge de travail, DUERP ?
- Bonnes pratiques de documentation et de défense préventive
- Les enjeux : regards croisés des juridictions

Quels sont les items à intégrer dans le DUERP en matière de RPS ?
Le DUERP doit recenser tous les facteurs susceptibles d’altérer la santé mentale, physique ou sociale des salariés.
En matière de RPS, on doit retrouver les 6 thématiques suivantes ; On s’appuie généralement sur le modèle de l’INRS / ANACT :
Identification des indicateurs de risques :
▶️ les exigences du travail (quantité, pression temporelle, complexité, équilibre vie professionnelle/vie privée) ;
Cette catégorie initiale englobe les concepts d’« exigences psychologiques » selon le modèle de Karasek et « d’efforts » d’après le modèle de Siegrist. Elle inclut également des éléments comme les contraintes de rythme, la présence d’objectifs irréalistes ou peu clairs, la nécessité de polyvalence sans formation adéquate, les consignes contradictoires, les journées de travail prolongées, les horaires de travail atypiques, ainsi que l’imprévisibilité des horaires de travail.
▶️ les exigences émotionnelles (contact avec le public, gestion des émotions)
Les exigences émotionnelles concernent la nécessité de gérer ses émotions, de les dissimuler ou de les simuler. Elles sont particulièrement présentes dans les métiers de services, où l’on peut rencontrer des tensions avec le public. Cette exigence de dissimulation émotionnelle peut également s’appliquer à d’autres secteurs lorsque la culture d’entreprise impose un contrôle total de soi en toutes circonstances et une démonstration permanente d’une « attitude positive ».
▶️ l’autonomie et les marges de manœuvre
L’autonomie au travail se réfère à la capacité d’être proactif dans ses tâches professionnelles. Elle est liée au concept de « latitude décisionnelle » du modèle « job strain » de Karasek et englobe non seulement la possibilité de s’organiser soi-même dans son travail, mais aussi la participation aux décisions ayant un impact direct sur ses activités, ainsi que l’opportunité d’utiliser et de développer ses compétences.
▶️ les relations sociales et de travail (coopération, reconnaissance, management)
Les relations sociales au travail ont fait l’objet de nombreuses études, notamment à travers le concept de « soutien social » du modèle de Karasek, l’« équilibre efforts/récompenses » du modèle de Siegrist. Cette catégorie couvre les relations professionnelles avec les collègues et la hiérarchie, les perspectives d’évolution de carrière, l’adéquation des tâches aux compétences de l’individu, les méthodes d’évaluation du travail, ainsi que l’attention accordée au bien-être des employés.
▶️ les conflits de valeur
Les conflits de valeurs font référence aux tensions internes qui surviennent lorsque les exigences professionnelles entrent en contradiction avec les valeurs personnelles, sociales ou professionnelles des employés.
▶️ l’insécurité socio-économique
Cette catégorie englobe à la fois l’insécurité socio-économique, telle que la crainte de perdre son emploi ou la précarité du contrat de travail, ainsi que le risque de changements non maîtrisés dans les tâches et les conditions de travail, comme les restructurations.

Comment prouver qu’un salarié n’est pas en surcharge ? Bien qu’il se dise surchargé ?
Lorsqu’un salarié se dit en surcharge, cela relève d’un ressenti subjectif, qui doit être entendu, mais qui ne suffit pas à prouver une surcharge objective de travail.
L’enjeu est donc de documenter, objectiver et croiser les faits.
▶️ Reconstituer la charge réelle de travail
Vous devez démontrer que le volume de tâches confiées est compatible avec le poste, le temps et les moyens.
Outils et preuves possibles :
- Fiche de poste : claire, à jour, et cohérente avec le niveau hiérarchique et la classification.
- Planning hebdomadaire / horaires réels : montrer que les horaires sont raisonnables, sans débordement systématique.
- Suivi du temps / pointeuse / badgeuse / timesheet / agenda Outlook : permet de prouver que le salarié ne dépasse pas les horaires contractuels.
- Volume de mails / tickets / dossiers traités : utile pour comparer la productivité à la moyenne de l’équipe.
- Répartition de la charge entre collègues : montrer qu’il n’y a pas d’écart significatif et injustifié.
▶️ Examiner la charge perçue vs. charge prescrite
La surcharge ressentie peut venir :
- d’un manque de priorisation ou d’une désorganisation personnelle,
- d’une difficulté relationnelle (manque de soutien, mauvaise communication),
- ou d’un écart entre les attentes et la réalité du poste.
▶️ Tracer les mesures de prévention prises
Même si le salarié exprime un ressenti de surcharge, l’employeur doit montrer qu’il a analysé, vérifié et agi.
- Courriel de proposition d’entretien pour comprendre la plainte,
- Ajustement temporaire des objectifs,
- Rappel sur la gestion des priorités,
- Proposition de formation ou d’entretien avec la médecine du travail.
Ces éléments protègent juridiquement l’entreprise : ils montrent que vous ne restez pas passif.
À éviter :
- Ne pas se contenter de dire “il n’est pas en surcharge car il finit à l’heure” : la charge peut être cognitive, émotionnelle ou qualitative.
- Ne pas ignorer le signal : une plainte répétée sans trace de réponse met en risque l’employeur (jurisprudence constante en matière de RPS).
Vous pouvez télécharger un modèle de grille d’évaluation à adapter en fonction de votre situation : télécharger

Comment prouver qu’un témoignage anonyme n’est pas un faux ?

Quels sont les risques professionnels liés à l’intégration de l’IA dans l’entreprise ?
L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’entreprise transforme le travail, mais elle apporte aussi de nouveaux risques professionnels, à la fois humains, organisationnels, techniques et éthiques.
▶️ Risques organisationnels et liés à la charge de travail
- Surcharge cognitive : nécessité de comprendre, paramétrer et interpréter les outils IA, surtout quand les décisions reposent sur des algorithmes complexes.
- Perte de sens et de contrôle : sentiment d’être “piloté par la machine”, surtout lorsque l’IA prescrit ou évalue les performances.
- Intensification du travail : automatisation partielle = plus d’objectifs, plus vite, moins de marges de manœuvre.
- Brouillage des rôles et responsabilités : qui décide en cas d’erreur de l’IA ? (ex. RH, manager, data scientist ?)
▶️ Risques psychosociaux
- Stress technologique : anxiété face à la peur de ne pas maîtriser les nouveaux outils.
- Inquiétude sur l’emploi : peur du remplacement ou de la perte de compétences humaines.
- Isolement professionnel : réduction des interactions humaines, surtout si l’IA prend en charge des tâches de coordination ou de communication.
- Atteinte à l’autonomie : décisions automatisées (planning, notation, recrutement) qui limitent la marge d’action des salariés.
▶️ Risques liés à la sécurité des données et à la conformité
- Fuites ou usages abusifs de données personnelles (notamment via IA génératives ou outils SaaS externes).
- Erreur algorithmique : une décision erronée peut avoir des conséquences sociales, financières ou juridiques graves.
- Biais discriminatoires : IA d’aide au recrutement, d’évaluation ou d’allocation de ressources reproduisant des biais sexistes, raciaux ou sociaux.
- Perte de confidentialité : envoi involontaire d’informations sensibles dans des prompts ou des outils non sécurisés.
▶️ Risques techniques et ergonomiques
- Erreurs d’interprétation des résultats de l’IA : fatigue attentionnelle, confiance excessive dans l’algorithme (“biais d’automatisation”).
- Inadaptation des interfaces : surcharge d’informations, mauvaise ergonomie, notifications permanentes.
- Dépendance à l’outil : perte de savoir-faire humain et difficulté à “reprendre la main” en cas de panne.
▶️ Risques juridiques et éthiques
- Flou de responsabilité : si une IA prend une décision dommageable, qui est responsable ?
- Atteinte à la vie privée ou à la dignité : surveillance algorithmique, analyse des émotions, notation comportementale.
- Non-conformité au RGPD et à la future réglementation IA européenne (AI Act).
Les risques liés à l’intégration de l’IA doivent être intégrés dans le DUERP mais pas forcément tous au même niveau de détail.
➡️ si l’IA :
- modifie l’organisation du travail,
- change les modes de décision,
- ou influe sur les conditions de travail,
alors ses effets sur la santé, la sécurité et les conditions de travail doivent être intégrés dans le DUERP.

Comment agir en cas de burn-out ?
Les actions qui peuvent être menées par l’employeur pour prévenir les risques de surmenage professionnel :
▶️ Former et de sensibiliser les collaborateurs, les managers et les représentants du personnel (CSE) sur les risques liés au surmenage.
▶️ Détecter les salariés qui rencontrent des difficultés, dans l’avancement ou l’accomplissement de leur travail
▶️ Mettre en place une démarche QVCT (en savoir plus)
En cas de burn-out avéré :
▶️ Déclencher une visite médicale pour tout salarié qui présenterait certains symptômes.
▶️ solliciter une enquête auprès du supérieur hiérarchique et recueillir des témoignages
▶️ Mobiliser les missions d’inspection et d’alerte du CSE : inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, enquêtes obligatoires, le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits à la santé physique ou mentale des personnes, expertise en cas de risques graves identifiés, y compris en cas de risques psycho-sociaux.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
▪ lorsqu’il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
▪ et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Si ces 2 conditions sont remplies, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Vous souhaitez être accompagné dans la gestion de vos risques professionnels ?